The role of women in our unions. Q&A with Fanny Demontigny – President of SCFP-QC’s Conseil provincial des affaires sociales
PH- What prompted you to get involved in union work? FD- My involvement in union work goes back to the 2015 strike. I wanted to be actively involved in the battles and fight for better working conditions. There’s also a personal story behind this: my grandfather died from an occupational illness. That affected me and made me understand how critical workplace safety is. PH- Do you think women are well represented in the decision-making bodies of unions? FD- Not quite, although that’s changing. We see more women in union leadership positions, but there’s still some way to go to achieve full equality. PH- Are there barriers preventing women from accessing leadership positions in the unions? FD- Yes, and often, women are the ones who put up the barriers. We’ve grown up with the idea that a woman must be more present at home, that she has to juggle everything. We have to debunk that idea and encourage women to forge ahead and to take their place among the unions’ decision-makers. PH- Have you noted differences in the way women and men exercise their union leadership styles? FD- Yes. Generally, women tend to be calmer, which is really helpful for communications with members and the team. PH- What are the main challenges facing women union activists today? FD- There’s still the old perception that union leaders are men. It takes a lot of effort to break through that. There’s also prejudice about our ability to lead and make decisions. Women must be aware of these obstacles and move forward together. PH- In your opinion, do unions provide enough consideration to the issues that specifically affect women? FD- Increasingly so, yes. When a strike happens nowadays, the issue isn’t just wages, it’s also working conditions and work-family balance. We’re hearing more about these issues these days. PH- What initiatives or policies should be implemented to encourage more women to get involved in the unions? FD- We need training and support, and, above all, open-mindedness. Beyond that, women need to take chances. Make themselves heard, get involved, go forward with confidence. PH- Can you tell us about some effective methods that have promoted gender equality in your union? FD- Yes! Training geared toward women in the union workspace is really useful. It provides tools, helps create a support network and brings us together with other women who are going through the same things. Recently, the FTQ organized a feminist school event that provided many women members of SCFP-QC with the opportunity to develop projects in their own union environments. These projects are in development or have already been implemented in organizations such as Local 301 and in the social affairs sector. PH- What advice would you give to a woman who is hesitant about getting involved in a union?FD- If you feel like doing it, go for it. Don’t wait til someone invites you to the table. Take your seat, make your voice heard. If you believe in your values, you’ll find your place and you’ll make a difference. PH- How do you see the evolution of women’s role in the unions over the coming years? FD- I’m very hopeful. We already see more women getting involved and filling important positions, whether it’s at the CPAS or SCFP-Québec. The trend is happening, and it will continue. PH- Do you think that the presence of women activists is contributing to a change in union priorities and demands? FD- Yes, no doubt about it. Today, with women at the head of organizations, these issues are being forcefully promoted, along with the message about women’s rights. PH- What improvements are still needed to achieve full gender equality in unions? FD- A change in culture. All the organizations must encourage women to get involved and provide them with solid support. Often, women hesitate to voice their opinion for fear of not being good enough. If we show women that we’re here for them, they’ll start taking part. PH- Do you think that women union members receive as much media attention as their male counterparts? FD- That all depends, but sometimes they get judged when they speak too forcefully, because they’re often perceived as too emotional. Whereas a man in the same situation is seen as a strong leader. PH- Do you think that women’s demands are sometimes reduced to “women’s issues” instead of being considered major union issues? FD- Yes, but things are changing. We saw this with the public sector strike; there were broad discussions about women’s equality and working conditions. PH- Does your organization support you in better managing media relations and ensuring you’re being heard? FD- Yes, I have a lot of support from my organization, but I absolutely have to take the initiative to seek out the media and use social networks as a communication tool. PH- Do you think that social networks have changed the game for women by allowing them to bypass traditional media to get their message across? FD- Absolutely. Social media provides a direct, unfiltered platform where we can talk about our struggles and mobilize people. It’s a powerful tool for women who are union activists. But we must also continue to find new ways to convey our message.
La place des femmes dans nos organisations syndicales. Questions/Réponses avec Fanny Demontigny – Présidente du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP-QC
PH- Qu’est-ce qui vous a motivée à vous engager dans le syndicalisme ? FD- Mon engagement dans le syndicalisme remonte à la grève de 2015. J’avais envie de participer activement aux luttes et de me battre pour de meilleures conditions de travail. Aussi, il y a une histoire plus personnelle derrière ça : mon grand-père est décédé d’une maladie en lien avec son travail ça m’a marquée et m’a fait comprendre à quel point la prévention en milieu de travail est essentielle. PH- Pensez-vous que les femmes sont bien représentées dans les instances décisionnelles des syndicats ? FD- Pas assez, même si ça évolue. On voit plus de femmes dans des postes de dirigeants syndicaux, mais il reste encore du chemin à faire pour une vraie équité. PH- Y a-t-il des barrières qui freinent l’accession des femmes à des postes de leadership au sein des syndicats ? FD- Oui, et souvent, c’est nous-mêmes qui nous mettons ces barrières. On a grandi avec l’idée qu’une femme doit être plus présente à la maison, qu’elle doit tout concilier. Il faut déconstruire ça et encourager les femmes à foncer, à prendre leur place dans les instances syndicales. PH- Avez-vous observé des différences dans la manière dont les femmes et les hommes exercent le leadership syndical ? FD- Oui. En général, les femmes favorisent un leadership plus posé, ce qui aide beaucoup à la communication avec les membres et avec l’équipe. PH- Quels sont les défis principaux auxquels les femmes syndicalistes sont confrontées aujourd’hui? FD- Il y a encore cette vieille perception que les dirigeants syndicaux sont des hommes. Se faire une place demande beaucoup d’efforts. Il y a aussi des préjugés sur notre capacité à diriger et à prendre des décisions. On doit être conscientes de ces obstacles et avancer ensemble. PH- Selon vous, les syndicats prennent-ils suffisamment en compte les enjeux touchant spécifiquement les femmes? FD- De plus en plus, oui. Aujourd’hui, dans les grèves, ce ne sont pas seulement les salaires qui posent un problème, mais aussi les conditions de travail et la conciliation travail-famille. Ce sont des enjeux qu’on entend davantage maintenant. PH- Quelles initiatives ou politiques devraient être mises en place pour encourager davantage de femmes à s’engager dans les syndicats? FD- Il faut de la formation, du soutien et surtout de l’ouverture d’esprit. Mais au-delà de ça, il faut que les femmes osent. Lever la main, s’impliquer, y aller avec confiance. PH- Avez-vous des exemples de mesures efficaces qui ont été adoptées pour promouvoir l’égalité des sexes dans votre syndicat? FD- Oui ! Les formations dédiées aux femmes dans le milieu syndical sont vraiment utiles. Elles permettent d’avoir des outils, de créer un réseau de soutien et de s’entourer d’autres femmes qui vivent la même réalité. Récemment la FTQ a organisé un évènement l’école féministe qui a permis à plusieurs femmes du SCFP-QC de créer des projets dans leur milieu syndical. Les projets sont présentement en création ou même déployés tel qu’à la section locale du 301 et au secteur des affaires sociales. PH- Quel conseil donneriez-vous à une femme qui hésite à s’engager dans une organisation syndicale? FD-Si tu as envie de le faire, fonces. N’attends pas que quelqu’un t’invite à la table. Prends ta place, fais entendre ta voix. Si tu crois en tes valeurs, tu trouveras ta place et tu feras une différence. PH- Comment voyez-vous l’évolution du rôle des femmes dans les syndicats au cours des prochaines années? FD- Je suis pleine d’espoir. On voit déjà plus de femmes s’impliquer et occuper des postes importants, que ce soit au CPAS ou au SCFP Québec. La tendance est là, et ça va continuer. PH- Pensez-vous que la présence des femmes dans le mouvement syndical contribue à un changement dans les priorités et les revendications? FD- Oui, sans aucun doute. Aujourd’hui, avec des femmes à la tête des organisations, on les met de l’avant avec force et le message est plus fort pour les droits des femmes. PH- Que faudrait-il encore améliorer pour atteindre une véritable égalité hommes-femmes dans le syndicalisme? FD- Un changement de culture. Il faut que toutes les organisations encouragent les femmes à s’impliquer et leur donnent un vrai soutien. Souvent, les femmes hésitent à lever la main par peur de ne pas être à la hauteur. Si on leur montre qu’on est là pour elles, elles prendront leur place. PH- Pensez-vous que les femmes syndicalistes reçoivent autant d’attention médiatique que leurs homologues masculins? FD- Tout dépend, mais parfois le jugement est présent quand elles prennent la parole avec force, elles sont souvent perçues comme trop émotives. Alors qu’un homme dans la même situation sera vu comme un leader revendicateur. PH- Avez-vous l’impression que les revendications portées par des femmes sont parfois réduites à des « enjeux féminins » au lieu d’être considérée comme des questions syndicales majeures? PH- Oui, mais les choses évoluent. On l’a vu avec la grève du secteur public où les enjeux d’équité et de conditions de travail des femmes ont été largement discutés. PH- Est-ce que vous recevez un soutien de votre organisation pour mieux gérer la relation avec les médias et vous assurer d’être entendue? FD- Oui, j’ai beaucoup de soutien de mon organisation, mais je dois prendre l’initiative d’aller vers les médias et d’utiliser les réseaux sociaux comme outil de communication, c’est essentiel. PH- Pensez-vous que les réseaux sociaux ont changé la donne en permettant aux femmes de contourner les médias traditionnels pour faire entendre leur voix? FD- Absolument. Les réseaux sociaux donnent une plateforme directe, sans filtre, où on peut parler de nos luttes et mobiliser du monde. C’est un outil puissant pour les femmes dans le syndicalisme. Mais encore, nous devons toujours trouver de nouvelles façons de transmettre nos messages.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Paiement de l’équité salariale dans la santé et les services sociaux: le gouvernement de la CAQ ne tient pas parole
Voici ci-bas le communiqué de presse. Bonne lecture!
ACCORD D’ÉQUITÉ SALARIALE CONCERNANT LES ÉVALUATIONS DU MAINTIEN DE 2015 ET DE 2020
Vous trouverez ci-bas le lien vers l’entente d’équité salariale pour la catégorie 3. Bonne lecture!
CAMPAGNE 2024 DU CPAS ET DU SCFP SUR LES RÉSIDENCES À ASSISTANCE CONTINUE (RAC)
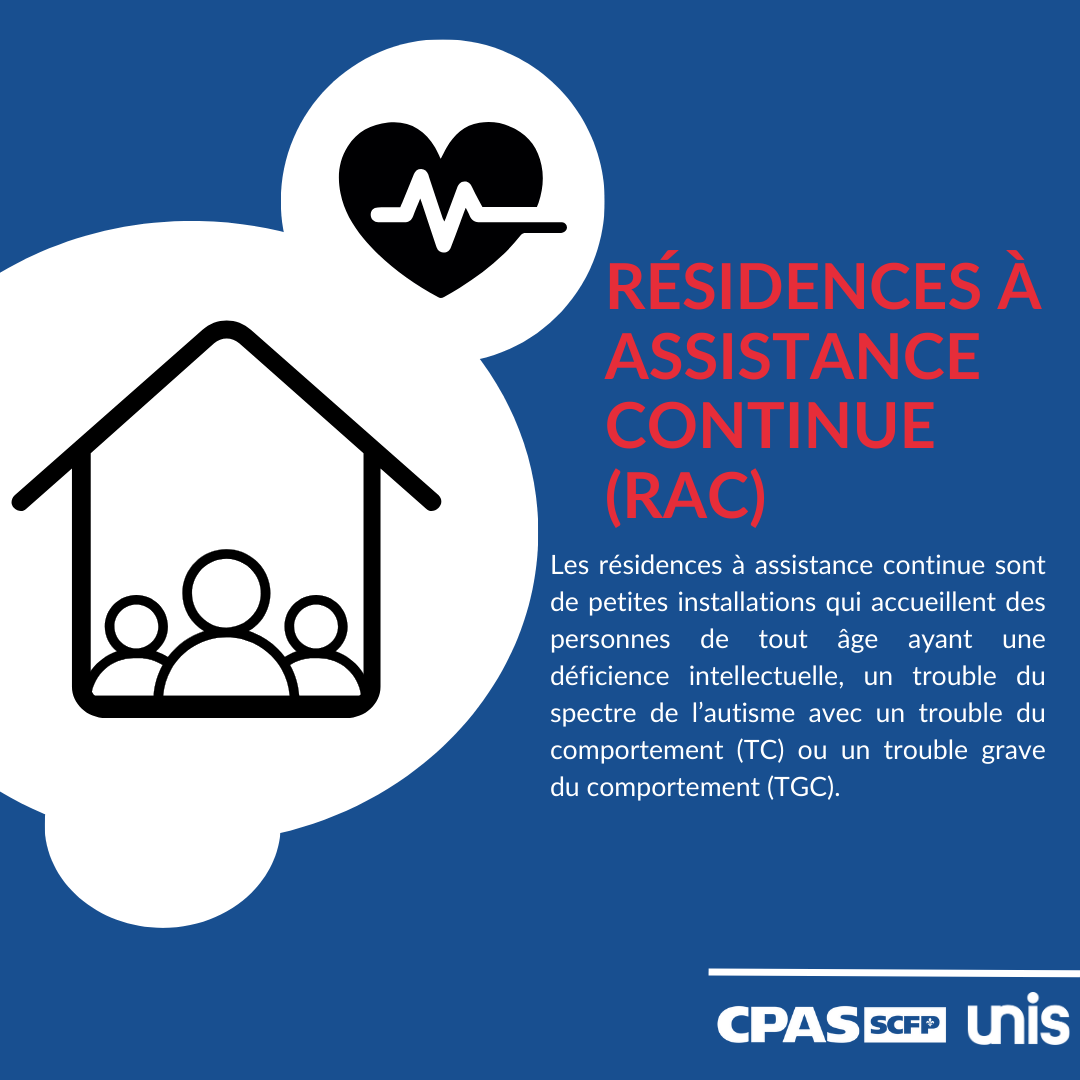
Ce printemps 2024, le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) et le SCFP ont mené conjointement une campagne de sensibilisation sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail et la vie des personnes usagères dans les RAC. Ils ont fait appel à des personnalités qui s’illustrent dans les médias sociaux, des « influenceurs » ou « influenceuses », pour porter le message. Voici l’ensemble des vidéos et capsules produites dans le cadre de cette campagne. Bonne écoute!
LA NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC VUE DE L’INTÉRIEUR – Article du journal La Revue de Mars 2024

Tout au long de la négociation, nous avons énormément entendu parler de la négociation du secteur public dans les médias. Notre cher premier ministre de même que notre ministre du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) s’en sont donné à cœur joie sur la place publique. Les chefs représentant chacune des organisations du Front commun ont aussi fait état de la négociation lors de conférences de presse et ont dû, à de multiples reprises, rectifier les propos mensongers du gouvernement. Mais qu’en était-il de l’intérieur? On m’a demandé de tenter de vous expliquer à quoi ressemble la vraie négociation, comment ça se passe réellement dans les coulisses du Conseil du trésor. J’y étais à titre de coordonnatrice et porte-parole pour la FTQ. Fait inusité, j’étais la seule femme qui siégeait à la table de négociation pour le Front commun alors que le secteur public est composé à plus de 78 % de femmes. En fait, j’aurai été la première femme porte-parole pour la FTQ dans les négociations du secteur public. LE FRONT COMMUN Comme vous le savez, la négociation s’est déroulée en Front commun FTQ, CSN, CSQ et APTS. À la table centrale, l’équipe de négociation était composée de huit personnes provenant de la FTQ, la CSN et la CSQ dont un porte-parole pour chacune des trois centrales syndicales. Cette alliance a permis de rassembler plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux. Elle a également mené à la plus grande marche nationale et au plus important mouvement de grève depuis des décennies. Cette alliance a cependant apporté son lot de défis. Jumeler ces trois grandes centrales était une chose, mais il fallait aussi en arriver à un projet commun qui répondait aux demandes des membres de chacune des organisations. Ensuite, ajouter à ce regroupement l’APTS, un syndicat indépendant, pour une première fois. Avoir chacun ses idées, sa vision, ses modes de fonctionnement, sa façon de négocier et trois porte-parole syndicaux à une même table, bref, ce n’était pas une mince affaire! Pour pouvoir y parvenir, il fallait avoir un but commun ultime : faire plier le gouvernement Legault et obtenir de meilleures conditions pour nos membres. LA NÉGOCIATION La négociation avec le gouvernement du Québec aura finalement duré plus d’un an. Au total, c’est 42 séances de négociation comportant nombre de caucus patronaux qui n’en finissaient plus et des allers-retours à Québec pour prendre part à des rencontres où l’on ne discutait avec l’employeur qu’une heure ou deux à peine dans une journée, le tout sans oublier leurs contre-offres qui prenaient des heures à revenir du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) car ils écrivaient des textes à vingt personnes alors que la porte-parole patronale savait très bien que ce qu’ils déposaient serait rejeté. Et que dire du fameux nouveau centre de négociation du gouvernement? Un seul mot : insalubre! Des locaux inadéquats, minuscules où régnait une chaleur qui rendait le tout inconfortable même pour les plus frileux. Après deux ou trois rencontres en ces lieux, nous sommes retournés négocier au complexe H. Il était alors difficile d’avoir accès à des salles de caucus, il faisait toujours aussi chaud, mais du moins, ce n’était pas insalubre. Ensuite, lorsque nous avons négocié sur de plus longues périodes, nous avons eu droit à un accès restreint à la salle des toilettes. Ces dernières n’étant plus accessibles après 17 heures, il fallait en faire la demande à l’agent de sécurité. Le gouvernement croyait peut-être nous faire flancher en raison de ces piètres conditions! Avons-nous réellement négocié dès le début? Les représentants patronaux vous répondront assurément oui, mais en toute honnêteté, la VRAIE négociation a réellement débuté dans les six dernières semaines des pourparlers. Nous avons perdu énormément de temps à discuter, notamment, des forums et des lieux de négociation des différents sujets. Nous avons ensuite fait face pendant des mois à des porte-parole sans mandats qui tentaient de nous vendre les offres salariales ridicules du gouvernement et du bien fait de leurs attaques sur le régime de retraite. Ils ont même poussé l’audace en nous proposant de nous fournir un verbatim pour faire accepter leurs offres par nos membres. La partie patronale nous ramenait constamment vers un règlement global et refusait de consigner ce qui était entendu entre les parties. Pire, nos vis-à-vis nous présentaient constamment des mesures patronales pour lesquelles nous savions déjà – grâce à d’autres canaux – qu’elles ne faisaient plus partie des sphères du gouvernement. L’arrivée des médiateurs à la table centrale à la mi-novembre a donné un nouveau souffle à la négociation. C’était en fait une première. En d’autres termes, cette demande de médiation de la part de la partie syndicale a ébranlé les colonnes du temple! Le gouvernement, toujours omniprésent sur la place publique, était bien mal placé pour la refuser. À partir du 21 novembre, nous avons été en négociation six jours sur sept. Il y avait encore de longs caucus patronaux, mais du moins, les médiateurs les confrontaient et les obligeaient à arriver avec des réponses. Enfin, la vraie négociation pouvait commencer. Nous avons ainsi pu avancer sur quelques sujets, mais en date du 17 décembre, il demeurait toujours des enjeux majeurs. C’est à ce moment que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a décidé de faire intervenir un de ses négociateurs en chef, celui-là même qui tient les cordons de la bourse. Ils ont alors tenté de nous convaincre que le SCT avait tout mis ce qu’il pouvait sur la table; que nos membres auraient plus que l’inflation prévue; que s’ils nous donnaient plus, ils devraient couper aux tables sectorielles. Bref, c’est le moment où ils nous ont joué du violon! Est ensuite venu le discours qu’ils avaient compris, qu’ils nous avaient entendus et qu’ils allaient nous faire une nouvelle offre. Quelle était cette super offre? Ils ajoutaient un maigre 0,3 %. On passait donc de 12,4 % à 12,7 % sur 5 ans. Wow! Le 23 décembre, après une journée de négociation jusqu’au petit matin, nous en étions toujours à 12,7 %
DOSSIER SPÉCIAL FONDS DE GRÈVE – Article du journal La Revue de Mars 2024

LA GRÈVE COMME MOYEN ULTIME La grève et le lock-out représentent les ultimes recours lors des négociations entourant une convention collective. La grève vise à priver l’employeur des revenus et des bénéfices générés par le travail des employés, tandis que le lock-out prive les travailleurs de leur emploi et de leurs salaires. Heureusement, ces moyens de pression ne sont utilisés que dans environ 4% de l’ensemble des négociations de conventions collectives au Québec1. Ainsi, on peut conclure que les arrêts de travail demeurent l’exception plutôt que la règle, et dans une large mesure, les parties préfèrent parvenir à un consensus. Cependant, il arrive que certaines situations contraignent les employés à recourir à ces mesures drastiques. Par exemple, lorsque l’employeur persiste à proposer des augmentations salariales qui représentent à peine 50% du taux d’inflation prévu, les travailleurs peuvent se sentir contraints d’exercer leur droit de grève. C’est précisément ce qui a conduit les membres du front commun à arrêter le travail pendant 11 jours à l’automne 2023. LE FONDS DE GRÈVE COMME COUSSIN FINANCIER Il est recommandé que chaque individu ou famille constitue un fonds de prévoyance capable de couvrir ses besoins ainsi que ceux de sa famille pendant une période minimale de 2 à 3 mois. Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui éprouvent des difficultés à constituer ou à maintenir ce coussin financier. Une alternative collective consiste à opter pour la création d’un fonds de grève, offrant ainsi une solution à cette problématique. Le fonds de grève, établi de manière collaborative, fournit un moyen de contourner les défis liés à l’accumulation individuelle de ressources financières. L’indemnité de grève qui en découle représente un revenu minimum garanti. Cette disposition permet de ne pas entraver la possibilité de s’engager dans la lutte pour l’amélioration des conditions de travail lorsque cela devient nécessaire. En choisissant cette approche collective, les individus se donnent les moyens de préserver leur capacité à revendiquer leurs droits en réduisant les conséquences financières immédiates. UN EXCELLENT LEVIER DE NÉGOCIATION Lors de notre récente grève en front commun, les questions relatives aux fonds de grève ont suscité un vif intérêt dans l’espace médiatique. Des interrogations ont émergé quant à la raison pour laquelle certains syndicats ne disposent pas de tels fonds2, et pourquoi d’autres établissent des critères d’accès particulièrement stricts3. Ces préoccupations n’ont pas été soulevées au sein du Syndicat Canadien de la Fonction Publique. Avec une caisse de grève excédant les 130 millions de dollars et des mécanismes permettant une recharge rapide en cas de besoin, le fonds de grève du Syndicat Canadien de la Fonction Publique se positionne parmi les plus efficaces et enviables au Canada et en Amérique du Nord. Lors des négociations de conventions collectives, le fonds de grève assume initialement un rôle dissuasif face à l’employeur. Le simple fait de savoir que les travailleurs ne seront pas complètement privés de revenus durant une grève ou un lock-out suffit souvent à persuader un employeur d’améliorer ses offres. Ce levier de négociation vise également à contrer la menace de l’employeur consistant à priver les travailleurs de leur source de revenus. Le fonds atteint son plein potentiel en cours de grève ou de lock-out, soutenant financièrement les travailleurs privés de leurs salaires pendant le conflit de travail. À l’heure actuelle, l’indemnité de base par semaine de grève s’élève à 300 $, pouvant atteindre 400 $ après 12 semaines. De plus, la caisse peut couvrir les assurances collectives et même la part de l’employeur en cas d’interruption de paiement de sa part4. LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE DU SCFP. Notre fonds de grève est ancré dans nos statuts et règlements depuis 2001, devenant ainsi une composante essentielle de notre identité syndicale. Au fil des ans, il a évolué, ce qui a conduit à l’adoption de plusieurs modifications visant à améliorer son efficacité et sa viabilité. Ces changements ont été intégrés grâce à des amendements adoptés lors de nos instances au sein du Syndicat Canadien de la fonction publique (voir l’encadré pour les détails). L’une des modifications majeures a été d’accorder le droit aux allocations de grève dès le premier jour d’arrêt de travail. En effet, avant 2017, l’indemnité n’était versée qu’après trois jours de conflit. Cette évolution reflète l’engagement constant du SCFP à ajuster et à optimiser notre fonds de grève pour mieux répondre aux besoins des travailleurs, renforçant ainsi notre capacité à soutenir ses membres dès le début d’un conflit de travail. Depuis 2001, la cotisation individuelle à notre caisse de grève correspond à un pourcentage, actuellement fixé à 5%, des capitations versées au SCFP, lesquelles représentent 0,85% du salaire5. Pour illustrer, si votre salaire est de 1000$/semaine, la portion de votre cotisation versée au SCFP sera de 8,50$. De ce montant, 42,5 cents (5%) ira à la caisse nationale de grève. Nos statuts ont intégré un mécanisme additionnel : en cas de diminution de la caisse sous les 50 millions de dollars, le SCFP est tenu d’augmenter la cotisation à 6% des capitations, et ce, jusqu’à ce que la caisse atteigne 80 millions de dollars6. Pendant cette période, le SCFP peut également transférer 4% des capitations destinées à la caisse nationale de défense vers la caisse nationale de grève7. Si ces mesures ne suffisent pas, un second déclencheur autorise le SCFP à augmenter la capitation de 0,04% (de 0,85% à 0,89%) si la caisse de grève passe sous les 15 millions de dollars, et ce, jusqu’à ce qu’elle atteigne 25 millions de dollars8. Ces ajustements permettre de maintenir une caisse de grève robuste et fonctionnelle pour soutenir nos membres dans les moments cruciaux. IL EST TEMPS DE PASSER À LA CAISSE Les exemples suivants démontrent de manière pragmatique comment le fonds de grève agit comme un levier financier, générant des bénéfices significatifs pour les travailleurs. Prenez note que ces exemples ne tiennent pas compte les bonifications et autres allocations de grève qui peuvent être versées par les sections locales. Voici les cas de Chantal et Mariette lors de la dernière grève en front
Écho des négos – Entente de principe sectorielle
Le 24 décembre 2023, après plus de cinquante (50) rencontres de négociation a eu lieu la conclusion d’une entente de principe à la table sectorielle. Vous pouvez consulter les points principaux de cette entente, en français et en anglais, en cliquant sur le lien ci-dessous.
Retards des paiements dus : protestez en transmettant une lettre à Dubé et Lebel
Afin d’exprimer votre mécontentement quant aux retards dans les paiement dus au personnel de la santé et des services sociaux, téléchargez cette lettre, signez-la et transmettez-la par courriel à Christian Dubé et à Sonia Lebel. Instructions par étapes : Téléchargez la lettre. Inscrivez la date du jour (au haut) puis ajoutez votre nom ou signature et vos coordonnées (au bas). Transmettez-la à partir de votre boîte courriel à ces deux adresses : ministre@msss.gouv.qc.ca;cabinet@sct.gouv.qc.ca Partagez cette page à vos collègues! Bravo! Vous avez protesté! Merci d’appuyer les travailleur.se.s du réseau de la santé et des services sociaux, lesquels sont tous affectés par ces retards de paiements!
Signature de la convention collective 2020-2023
La nouvelle convention collective a été signée aujourd’hui. Elle couvre du 1er avril 2020 au 31 mars 2023. Elle entrera en vigueur le 24 octobre 2021. Ceci clôt un processus de près de trois années. Afin de connaître les dates clés à venir, notamment des paiements de rétroactivité, nous vous invitons à consulter l’Écho des négo n°10.